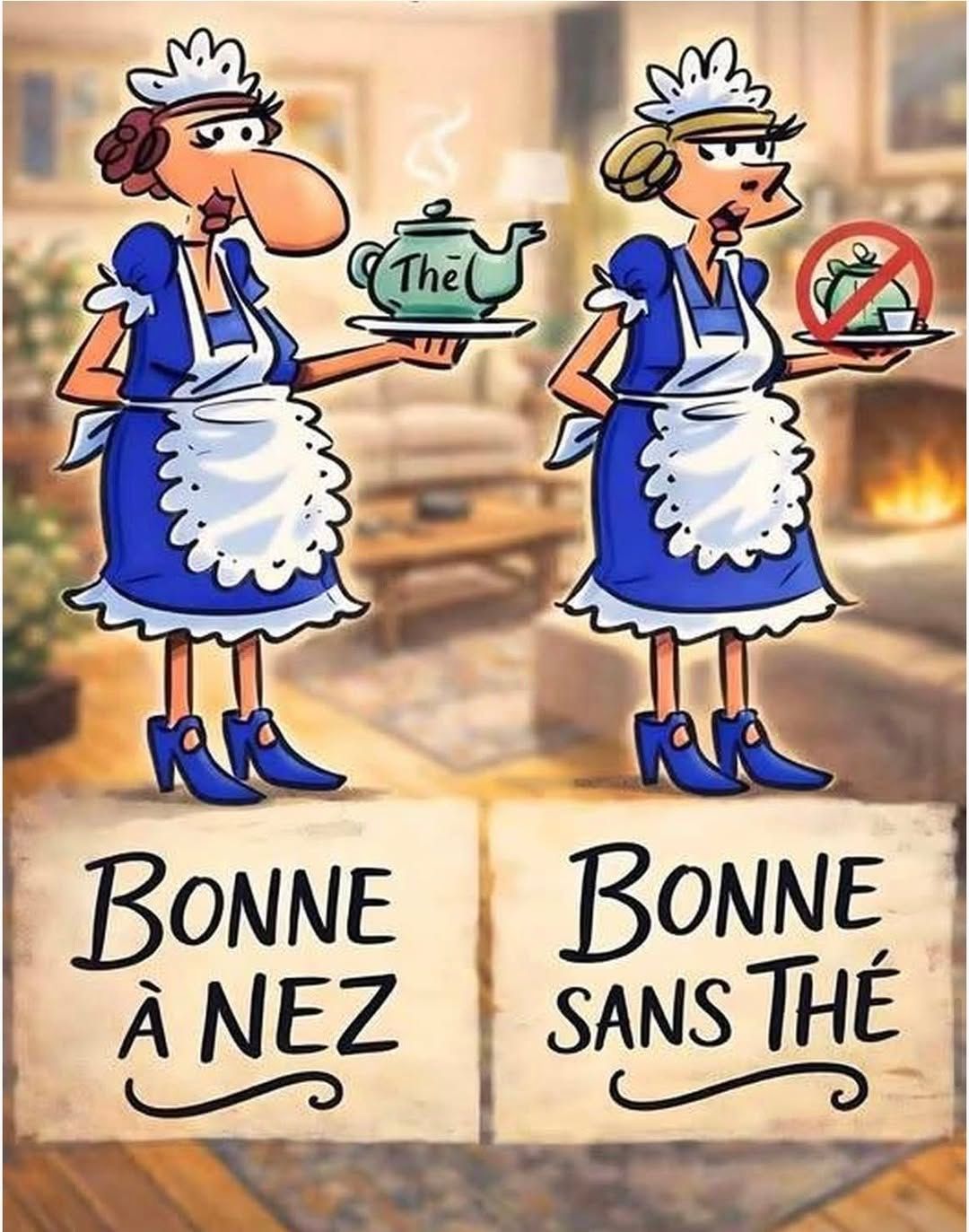« Valeur sentimentale » de Joachim Trier, avec Renate Reinsve, Stellan Skarsgard, Inga Ibsdotter Lilleaas et Elle Fanning.
Assiste t-on à un renouveau du cinéma Nord Européen ?
Après la «Trilogie d’Oslo» du Norvégien Dag Johan Haugerud, « Valeur sentimentale » de Joachim Trier, Grand Prix au dernier festival de Cannes, nous ramène dans la capitale norvégienne, témoignant ainsi de la vivacité du cinéma actuel norvégien, en particulier, et scandinave, en général.
Danois et Norvégien, Joachim Trier est en effet apparenté au cinéaste Danois Lars von Trier et l’acteur principal de « Valeur sentimentale », Stellan Skarsgard, est Suédois.
Dans un récent témoignage, ce dernier a créé une polémique en rappelant le passé nazi d’Ingmar Bergman et son comportement sadique envers les comédiens, contrairement à un Joachim Trier, plus attentif et plein d’empathie à leur égard.
Et pourtant, par bien des côtés, le film de ce dernier n’est pas sans évoquer ceux de son illustre prédécesseur.
Dans une magnifique maison de bois noir et rouge, aux allures de datcha antique, matrice sur plusieurs générations de tous les traumas familiaux, Agnes et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence.
Cinéaste de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre confirmée, de jouer dans son prochain film.
Face à son refus, il confie alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant des souvenirs de famille douloureux.
L’occasion pour le réalisateur de « Julie (en 12 chapitres) » de retrouver son actrice fétiche, Renate Reinsve, et de lui offrir un rôle à sa mesure dont elle s’acquitte avec maestria.
Ici, grâce à un scénario ingénieux, c’est la mémoire de la maison d’Oslo, et sa fêlure originelle, qui conduisent la narration.
Une narration structurée en plusieurs temps et époques et permet au cinéaste de mettre au jour l’intimité des sentiments tendres ou douloureux des protagonistes et de leurs relations conflictuelles : père-filles ou metteur en scène et actrices.
Le film nous offre ainsi une variation subtile entre le théâtre (le corps global) et le cinéma (le corps éclaté), la réalité et la fiction, l’art et la vie.
Avec des plans proprement… bergmaniens, à savoir que le cadre se focalise et scrute le visage des acteurs et actrices, faisant affleurer à la surface leur intériorité secrète et profonde.
Une pratique qui n’est pas, il faut bien l’avouer, exempt d’une certaine violence, impliquant un jeu forcément éprouvant pour l’interprète mais promesse d’émotions certaines pour le spectateur !
Le prix à payer ?
https://www.youtube.com/watch?v=wX91J8svFoA