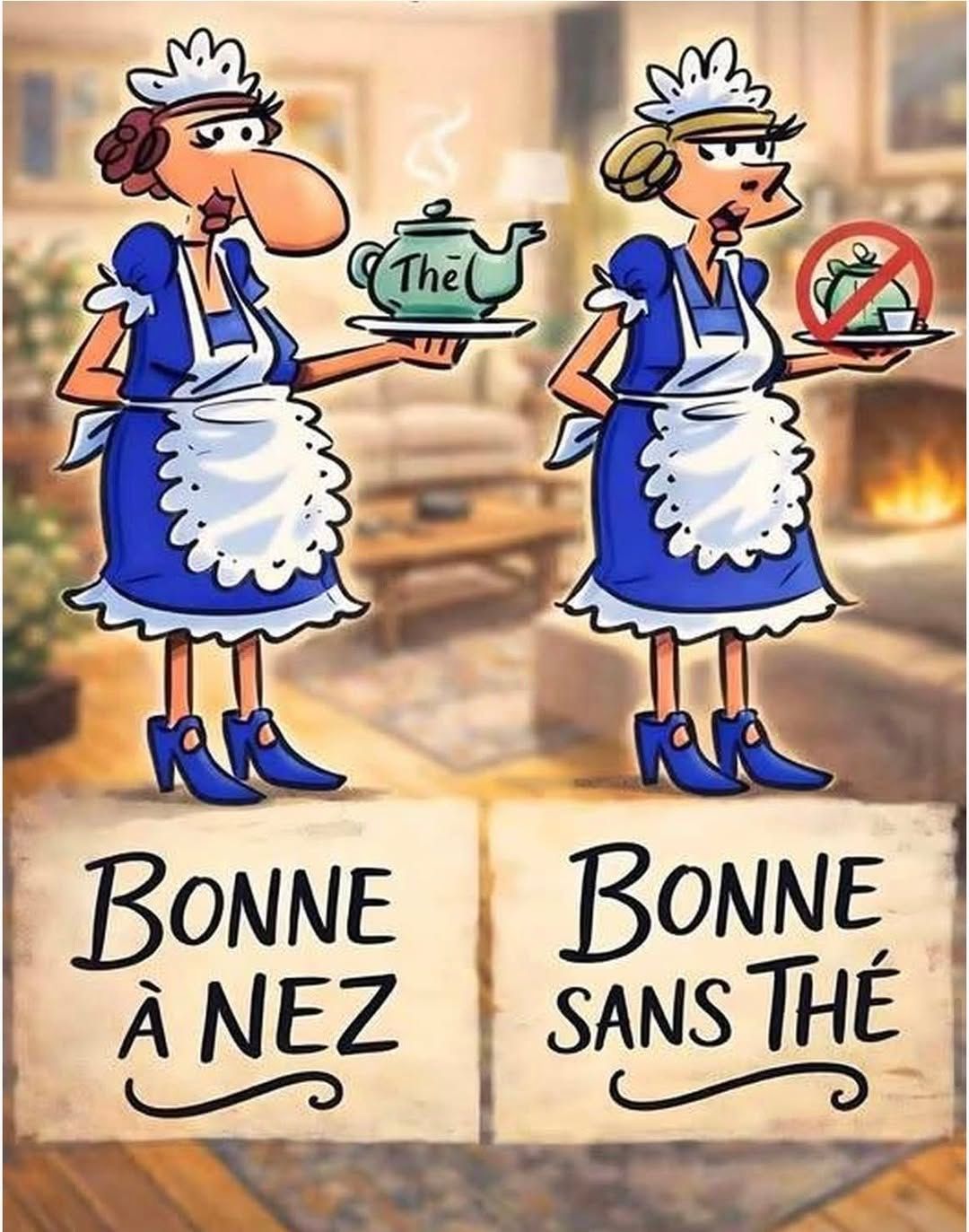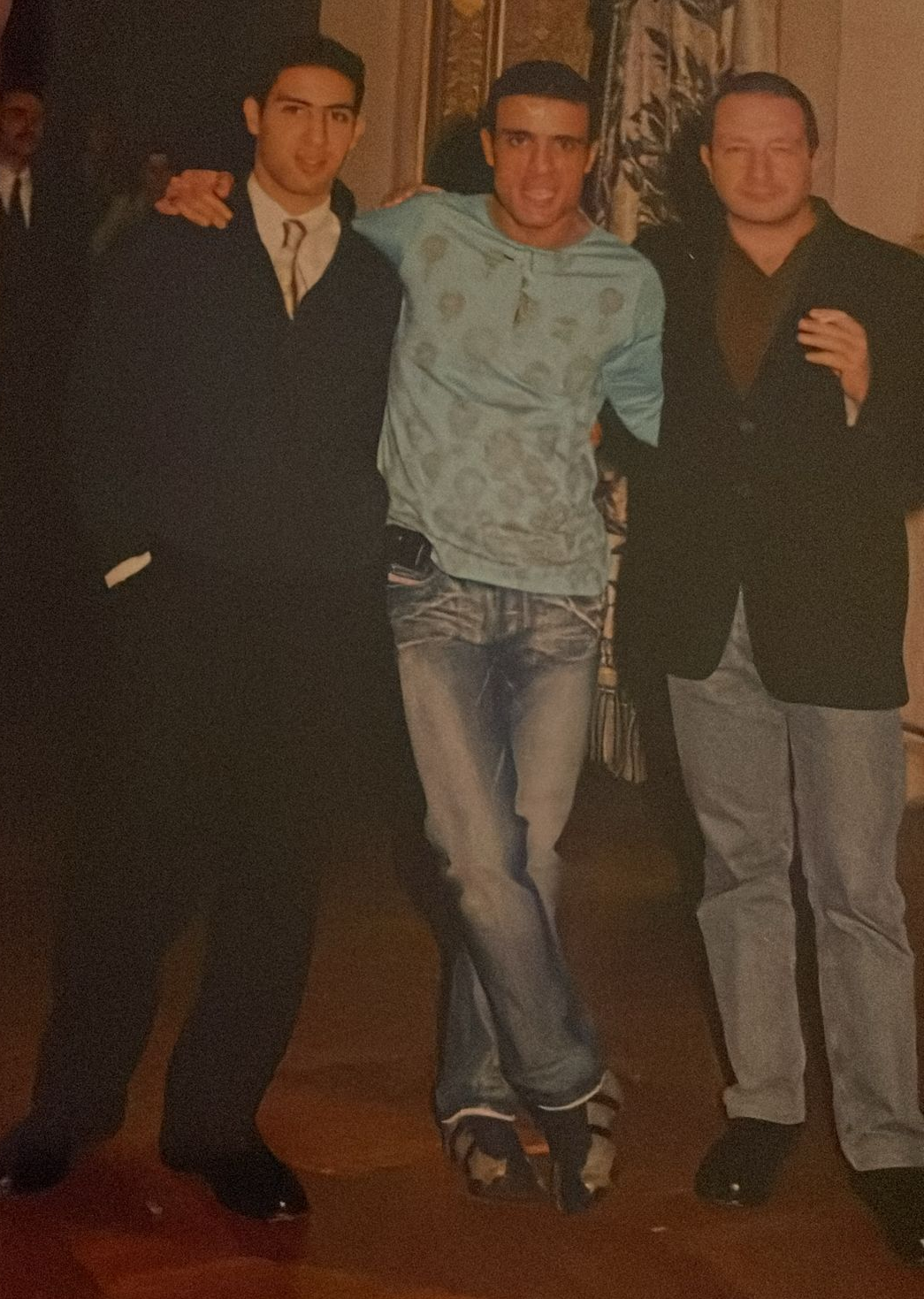Le cimetière des gloires nationales
Le 9 octobre, Robert Badinter, ancien ministre de la Justice de François Mitterrand, a fait son entrée au Panthéon. Sinon son corps, du moins son cercueil. Sa dépouille, quant à elle, demeure dans le carré juif du cimetière de Bagneux (Hauts-de-Seine), afin que son épouse, Élisabeth Badinter, puisse le rejoindre le moment venu. En guise de corps, cinq objets ont été déposés dans le cercueil : sa robe d’avocat, une copie de son discours sur l’abolition de la peine de mort et trois livres : Choses Vues de Victor Hugo, Condorcet : Un intellectuel en politique, ouvrage écrit en commun avec Élisabeth Badinter et Idiss, son livre écrit en hommage à sa grand-mère. Quand le corps n’est pas là, la
« panthéonisation », plus symbolique que réelle, ne perd t-elle pas en grande partie son sens ? D’autant plus que ce n’est pas la première fois que l’on assiste à une entrée au Panthéon sans corps.
Construit au XVIIIe siècle par décision de Louis XV en tant qu'église dédiée à sainte Geneviève et destinée à abriter les reliques de la sainte, le Panthéon fut transformé au début de la Révolution française (1789-1799) en un monument funéraire en l'honneur des grands personnages de l'histoire contemporaine, pour accueillir en premier lieu la dépouille du comte Honoré-Gabriel Riqueti de Mirabeau, mort en 1791 (il en sera retiré quelques mois plus tard à la suite de la découverte de sa correspondance secrète avec le Roi).
D’autres personnalités, à peine admises, en ont également été retirées par la suite, tels Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, Auguste Marie Henri Picot de Dampierre et Jean-Paul Marat.
Seuls deux illustres écrivains traverseront la période révolutionnaire : François Marie Arouet dit Voltaire entré au Panthéon en 1791, ainsi que Jean-Jacques Rousseau entré en 1794.

L'entrée solennelle du cercueil vide de Robert Badinter.
Bâti dans le style néo-classique sous la direction de Jacques-Germain Soufflot (1713-1780), son architecture reprend notamment la façade du Panthéon de Rome, annonciatrice de la destination future du monument ?
L'édifice, en forme de croix grecque, est surmonté d'un dôme haut de 83 mètres, inspiré du Tempietto de l'église San Pietro in Montorio, également à Rome.
D’une longueur de 110 m et d’une largeur de 84 m, sa façade principale est décorée d’un portique aux colonnes corinthiennes, surmonté d’un fronton triangulaire exécuté par David d'Angers.
Ce fronton représente la Patrie (au centre) donnant la Liberté et protégeant à sa droite les Sciences, les philosophes, les écrivains et les artistes et à sa gauche l'Histoire.
L’intérieur est décoré par des peintres académiques comme Puvis de Chavannes, Antoine-Jean Gros, Léon Bonnat ou Cabanel.

L'intérieur du Panthéon dans toute sa splendeur.
La crypte couvre toute la surface de l'édifice. Elle est constituée de quatre galeries, situées chacune sous les bras de la nef. Toutefois, elle n'est pas véritablement enterrée puisque des fenêtres, en haut de chaque galerie, s'ouvrent sur l'extérieur.
On y accède par une salle décorée de colonnes doriques (en référence au temple de Neptune à Paestum, que Soufflot avait visité pendant son voyage en Italie). En avançant, on découvre, au centre du bâtiment, la vaste salle voûtée de forme circulaire et la petite pièce centrale, située juste sous le dôme.
Les dimensions de la crypte offre une capacité totale d'accueil d'environ 300 places !
Après une longue période de déshérence sous la Restauration et le Second Empire, c’est seulement avec l'enterrement de Victor Hugo, en 1885, que l'édifice retrouve sa fonction définitive de panthéon.

Les manes de Voltaire.
En attendant l’entrée prochaine au Panthéon de l'historien et résistant Marc Bloch, le 16 juin 2026, on recense à ce jour 83 personnalités dont le gouvernement au pouvoir a décidé la « panthéonisation ».
Parmi elles, seules 74 personnalités ont une tombe, un cénotaphe ou une urne funéraire dans la crypte du monument : Voltaire y a été transféré sans son coeur ni son cerveau (récupérés, l’un et l’autre, lors de son autopsie par le marquis de Villette et l’apothicaire Mitouart) ; Louis Braille, inventeur de l’écriture tactile pour les aveugles, a été inhumé sans ses mains (conservées dans une urne scellée à Coupvray en Seine-et-Marne, ville d’où son corps a été exhumé en 1952) ; seul le coeur de Léon Gambetta, prélevé lors de l’autopsie du père fondateur de la IIIe République, demeure dans une niche de l’escalier qui descend à la crypte depuis le 11 novembre 1920 alors que sa dépouille est enterrée à Nice ; tandis que les cendres
« présumées » de Jean Moulin ont été transférées au Panthéon en 1964 ainsi que les cénotaphes de Joséphine Baker, qui repose à Monaco, et d’Aimé Césaire, inhumé en Martinique.
Parmi ces 83 personnalités, six femmes y ont été inhumées pour leur propre mérite : Marie Curie, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillion, Simone Veil, Joséphine Baker et Mélinée Manouchian. Auxquelles s'ajoute Sophie Berthelot, épouse de Marcellin Berthelot, inhumée au Panthéon pour respecter leur souhait de ne pas être séparés dans la mort.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_personnes_transférées_au_Panthéon_de_Paris