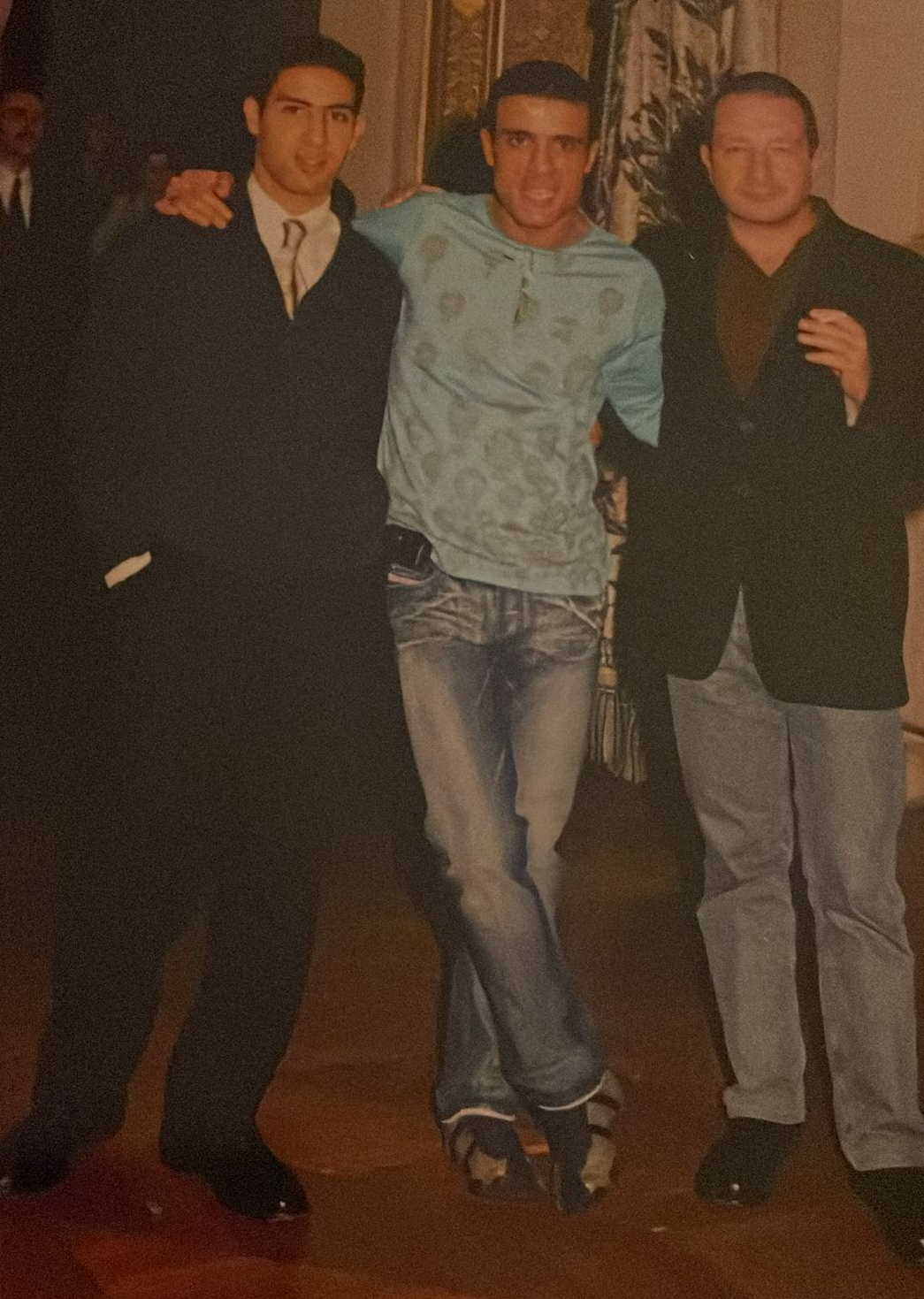Les jardinières de l’Hôtel de Ville
Une nouvelle « forêt urbaine » a été aménagée et ouverte au public sur le parvis de la Mairie de Paris.
Une forêt, croyez-vous ?
« Mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde » disait déjà Albert Camus.
Disons, qu'ici, tout au plus, il s'agit de deux charmants bosquets !
Beaux et inattendus comme un double décor de cinéma, plus artificiel que naturel toutefois.
Ces bosquets ont été créés en lisière de la Seine et de la rue de Rivoli, sur un peu plus du quart de la surface totale d’environ 9000m2 de l’ancienne place dont la partie centrale est restée quant à elle inchangée.
Entièrement dallée de granit avec, en son centre, la représentation de la nef, emblème de Paris, celle-ci avait été réaménagée en 1982, à l’occasion du centenaire de la reconstruction de l’Hôtel de Ville.

Un paysage inattendu du côte du Bazar de l'Hôtel de Ville, Rue de Rivoli.
C’est de cette époque que datent les deux grandes fontaines rectangulaires identiques, oeuvres du sculpteur François-Xavier Lalanne, qui isolent désormais la place de l’Hôtel-de-Ville de la rue de Rivoli et du quai de l’Hôtel-de-Ville.
Pour un rendu immédiat, l’actuelle municipalité s’est offert le luxe de déraciner des févier d'Amérique, des érables, des micocouliers Julian, des chênes chevelus de Bourgogne et des charmes communs…
Soit au total pas moins de 49 arbres adultes, de six à dix mètres de hauts, auxquels ont été ajoutés une centaine de petits arbres afin de les replanter en pleine terre dans une surface d’à peine 2 mètres de profondeur, compte tenu du parking souterrain.
De quoi craindre pour la suite…

Avant...
Et afin de renforcer l’aspect champêtre des lieux, elle n’a pas hésité non plus, comme à son habitude, à transformer les longs bassins des fontaines, dans lesquels se déversaient les gerbes d’eau en bouquets pyramidaux et en cascades, en vulgaires jardinières.
Épargnant seulement les larges margelles accueillantes aux promeneurs.
Un moindre mal, quand on se souvient que pour la « forêt urbaine » de la place de Catalogne (14e arr.), la municipalité avait purement et simplement supprimé la fontaine monumentale du Creuset-du-Temps, oeuvre du sculpteur d’origine polonaise Shamaï Haber !

... et après.

Une illusion végétale, pour un coût total des travaux s'élevant à 6 millions d'euros.

Côté Seine, sous les fenêtres du bureau de la maire de Paris.
Du port de Grève à la forêt urbaine
La place de Grève doit son nom au revêtement sablonneux incliné en pente douce vers la Seine, séparé d’une grande place par un petit muret.
Elle tire son nom de l'ancien port d’échouage, pour le déchargement des bateaux transportant des marchandises variées : charbon de bois, vin, chaux, etc.
Charrettes et chariots assuraient ensuite l’acheminement à travers la ville.
Le site se prolongeait vers l’est, en amont de la Seine, avec le port au Blé ou quai des Ormes, pour le ravitaillement en produits céréaliers.

La place de Grève par Jean-Baptiste-Nicolas Raguenet, 1751 (musée Carnavalet).

Du début du 14e siècle à 1832, la place de Grève (actuelle place de l'Hôtel-de-Ville), sert de cadre à toutes les exécutions publiques. L’exécution de Ravaillac (Rijksmuseum).
Devant l’hôtel de ville, la place de Grève accueille de nombreux divertissements populaires. On y célèbre les grands moments de la vie du royaume et différentes réjouissances, comme la traditionnelle fête de la Saint-Jean.
Durant cinq siècles, ce site est également utilisé pour la mise en scène des exécutions capitales.
Le sort réservé au supplicié dépendait de son délit : ainsi, il pouvait être brûlé, roué de coups, pendu ou encore décapité à la hache.
Et pour le pire des crimes, à savoir le régicide, était réservée la plus extrême des mises à mort : l’écartèlement.
C’est le sort qui fut réservé à Ravaillac en 1610, après qu’il eut poignardé le roi Henri IV : devant une foule en délire, qui le hua et le lyncha dès son arrivée sur son lieu d’exécution.
Le 28 mars 1757, c’est ici également que le domestique Damiens est supplicié pendant plus de deux heures.
En 1766, Lally-Tollendal meurt à son tour sous les coups de ses bourreaux, avant l’installation d’une guillotine en 1792.

Cette plaque, visible devant la façade de l’Hôtel de Ville, nous rappelle qu'ici, le 25 août 1944, acclamé par des milliers de Parisiens, le général De Gaulle à prononcé son célèbre discours de la Libération de Paris.
Texte et photos : © Jacques Barozzi