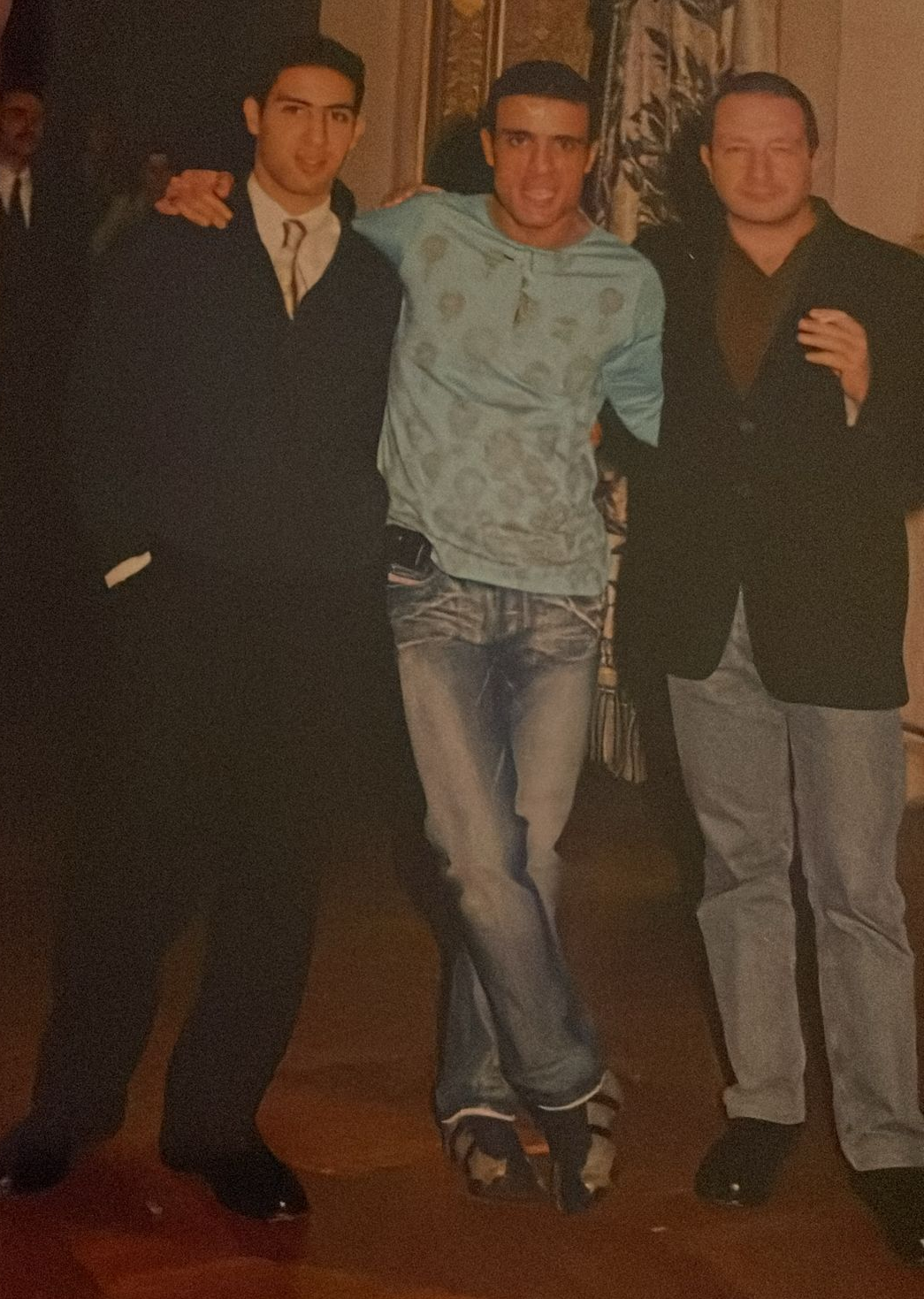4e arrondissement
Fontaine Sainte-Avoye
56, rue du Temple
Métro : Rambuteau
Etroite et plate, coincée entre deux boutiques, rue du Temple, juste après le croisement de la rue Rambuteau, cette fontaine, dite Sainte-Avoye, se remarque à peine.
Au point que l’on peut passer souvent devant elle sans jamais la voir.
Il ne reste rien ici, sinon le nom, de l’ancienne fontaine Sainte-Avoye, dont l’architecte Jean Beausire supervisa les travaux en 1682.
Déplacée et reconstruite en 1840 à l’emplacement actuel, celle-ci ne présente plus qu’un fronton triangulaire, aux armes de la Ville encadrées de deux dauphins, et un simple bouton pressoir tout juste digne d’une banale borne fontaine…
Fontaine Maubuée
Rue Saint-Martin, rue de Venise
Métro : Rambuteau
Après la fontaine de la Reine (2e arrondissement), Jean Beausire et son fils édifièrent, en 1733, cette fontaine, sise alors à l’angle de la rue Saint-Martin et de la rue Maubuée.
Située de l’autre côté de la rue Saint-Martin, dans le prolongement de la rue Simon le Franc, la rue Maubuée a laissé la place au site sur lequel se trouve désormais le centre Georges Pompidou. Démontée en 1937, la fontaine fut entreposée plus d’une trentaine d’années, avant de resurgir à l’angle des rues Saint-Martin et de Venise à l’occasion du remodelage complet du quartier Beaubourg.
Sur cette vieille fontaine à deux faces, on peut encore distinguer, côté rue Saint-Martin, un bas-relief représentant un vase et des plantes aquatiques.
En revanche, les armes royales, qui ornaient la corniche, ne sont plus guère reconnaissables.
Sur l’autre face, rue de Venise, le décor se limite aux armes de la ville, sur la corniche.
Mais la nef parisienne, représentée ici sous la forme d’une imposante galère appareillée de nombreux canons, semble prête à livrer un combat naval !
Fontaine Stravinsky
Place Igor-Stravinsky
Métro : Hôtel-de-Ville
C’est, incontestablement, la plus spectaculaire fontaine contemporaine réalisée dans la capitale.
Elle a été conçue par Jean Tinguely et est composée composée de seize figures noires ou multicolores réalisées par Tinguely et sa compagne, Niki de Saint Phalle, qui sont animées par la force de l’eau à l’intérieur d’un vaste bassin rectangulaire.
Aménagée en 1983 sur le parvis de l’Ircam (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique), la fontaine offre une heureuse transition entre les arches gothiques du chevet de l’église Saint-Merri et les tubulures vivement colorées du Centre Pompidou.
Sa margelle en acier inoxydable forme une banquette ininterrompue, ce qui en fait une halte ludique plébiscitée par les nombreux visiteurs du Centre Beaubourg et particulièrement appréciée des enfants.
Baptisée à l’origine Le Sacre du Printemps, elle rend hommage au compositeur Igor Stravinsky, ainsi que la place au centre de laquelle elle s’inscrit.
Ses automates sont en effet directement inspirés de l’œuvre du musicien.
Ils symbolisent ainsi les thèmes de la vie, de la mort ou de l’amour (le cœur, les lèvres rouges) ou représentent le bestiaire (serpent, éléphant) propre à l’univers fantasmagorique du compositeur russe, comme
L’Oiseau de feu dont la haute silhouette émerge au centre du bassin.
Fontaines de l’Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville
Métro : Hôtel-de-Ville
En 1982, pour marquer le centenaire de la reconstruction de l’Hôtel de Ville, la municipalité décida de réaménager complètement le parvis afin de mieux mettre en valeur l’architecture de la façade principale du bâtiment et de mieux pouvoir y rassembler les Parisiens, à l’occasion des divers rendez-vous festifs.
C’est ainsi que, l’année suivante, le site de l’ancienne place de Grève -où se déroulaient jadis les exécutions publiques- fut définitivement rendu aux piétons.
Entièrement dallée de granit avec, en son centre, la représentation de la nef, emblème de Paris, et bordée de deux grandes fontaines rectangulaires, la nouvelle place de l’Hôtel-de-Ville est désormais isolée de la rue de Rivoli et du quai de l’Hôtel-de-Ville.
La nef emblématique de Paris est représentée en son centre, et elle est bordée de deux grandes fontaines rectangulaires et fleuries.
Réalisées par le sculpteur François-Xavier Lalanne, ces fontaines identiques, superbement éclairées la nuit, projettent des gerbes d’eau en bouquets pyramidaux et en cascades qui se déversent dans un long bassin ceint de larges margelles accueillantes pour les promeneurs.
Ancienne fontaine des Guillemites
Square Charles-Victor-langlois, rue de l’Abbé-Migne
Métro : Rambuteau ou Saint-Paul-Le Marais
Si bon nombre de fontaines ont disparu au fil du temps, certaines d’entre elles nous ont laissé de belles traces. C’est le cas de la fontaine des Guillemites.
Datant de 1655 et reconstruite en 1719 par Jean Beausire à l’angle d’une maison de la portion amputée de la rue des Guillemites (l’actuelle rue de l’Abbé-Migne), elle a été accolée en 1930 contre le mur oriental de l’église des Blancs-Manteaux, à l’intérieur du square Charles-Victor-Langlois. On peut encore admirer ici ses deux pilastres doriques ornés de consoles à pendentifs de feuillages supportant un fronton triangulaire.
Anciennes fontaines du marché des Blancs-Manteaux
8, rue des Hospitalières-Saint-Gervais
Métro : Saint-Paul-Le Marais
Les deux fontaines du marché des Blancs-Manteaux ont disparu en 1910 lors de la fermeture de cette ancienne halle du quartier du Marais, dont on a conservé toutefois le bâtiment principal, créé à l’initiative du préfet Frochot en 1813 à l’emplacement du couvent des Hospitalières-Saint-Gervais. Ces fontaines paraient le mur extérieur de l’annexe du marché, ouverte en 1819, de l’autre côté de la rue des Hospitalières-Saint-Gervais pour y regrouper le commerce de la viande.
L’ancien pavillon consacré à la boucherie a été remplacé depuis par le groupe scolaire actuel.
Des deux fontaines, ne subsistent que les mascarons en bronze d’où jaillissait l’eau dans un bassin semi-circulaire.
Remontées à leur emplacement approximatif sur la façade du nouveau bâtiment, ces deux belles têtes de bœuf, cornues et parées pour le sacrifice, en référence à l’activité des lieux, ont été réalisées à l’époque de l’ouverture du pavillon de la boucherie par le sculpteur Edme Gaulle, le maître de Rude.
Fontaine de Jarente
Impasse de la Poissonnerie
Métro : Saint-Paul-Le Marais
Cette élégante fontaine de la fin du XVIIIe siècle, conservée en l’état, fait partie intégrante d’un lotissement privé réalisé par l’architecte Caron, maître-général des bâtiments du roi, au profit des propriétaires des lieux, les époux Marchand du Colombier.
Depuis 1786, elle se déploie entièrement sur le mur du fond de l’impasse de la Poissonnerie, ouverte à la même époque par Caron, à l’occasion de l’édification de la halle aux poissons du marché Sainte-Catherine.
Accessible par la rue de Jarente, du nom de l’un des prieurs du couvent de Sainte-Catherine, la poissonnerie occupait alors le rez-de-chaussée de l’immeuble situé à gauche de la fontaine.
Intégrant dans son dessin général les deux portes contiguës surmontées de tables ornées de fleurons, la fontaine de Jarente présente un bel ensemble, harmonieusement taillé dans la pierre par un sculpteur dont on n’a pas conservé le nom.
Formant un avant corps à ressauts, elle est encadrée de pilastres doriques à bossage de congélations alternées.
Des dauphins, des cornes d’abondance et un faisceau de licteur ornent le bas relief, que surplombe un fronton triangulaire décoré d’une urne renversée et de roseaux.
Fontaine de l’hôtel Colbert de Villacerf
23, rue de Turenne
Métro : Chemin-Vert
Derrière les grilles du 23, rue de Turenne, on peut toujours admirer la monumentale fontaine aménagée, côté cour, devant l’hôtel particulier construit vers 1650 pour l’intendant Colbert de Villacerf, le neveu du grand Colbert.
Si le bâtiment a quelque peu été dénaturé au fil du temps (il ne comptait à l’origine que deux étages au-dessus du rez-de-chaussée), la fontaine, pour sa part, est visiblement en parfait état.
Intégrée à la façade principale, entre les deux portes d’entrée, ce serait, si l’on en croit Jacques Hillairet, la plus ancienne des fontaines du XVIIe siècle.
Mais d’autres auteurs affirment, sans plus de précisions, qu’elle aurait été élevée en 1881 - ce qui semble plus probable.
Encadrée de pilastres à bossages géométriques alternés, elle est constituée d’une niche centrale ornée d’une nymphe tenant une cruche renversée.
A ses pieds, deux mascarons à têtes de lions complètent la décoration de cet imposant ensemble sculpté dans la pierre, que coiffe un chapiteau en demi-arc de cercle, d’où Neptune en personne nous fixe de son regard acéré.
Fontaines de la place des Vosges
Square Louis-XIII
Métro : Chemin-Vert
La place Royale, inaugurée en 1612 à l’occasion du mariage de Louis XIII, fut rebaptisée place des Vosges en 1800 en l’honneur du premier département ayant acquitté ses impôts.
En son centre, la statue équestre en bronze doré de Louis XIII, que Richelieu avait commandée en 1639 au sculpteur Pierre Biard, fut fondue à la Révolution.
Louis XVIII la fit remplacer en 1825 par le groupe actuel, en marbre blanc, dessiné par Charles Dupaty et sculpté par Jean-Pierre Cortot.
C’est alors que les quatre fontaines en pierre, parfaitement identiques, firent leur apparition aux quatre angles du jardin.
Réalisées d’après les dessins de l’architecte Jean-François Ménager, elles sont constituées d’un bassin circulaire au centre duquel s’élèvent deux piédouches supportant deux vasques de formes décroissantes.
Depuis la gerbe placée au sommet, l’eau ruisselle jusque au sol, après avoir été recrachée par les seize têtes de lion décorant la grande vasque intermédiaire.
Ces quatre fontaines cascadantes complètent à ravir le bel ordonnancement classique de l’ancienne place Royale.
En dehors de ces modifications ornementales et des plantations successives du jardin, la place, encadrée de trente six pavillons sur arcades en pierre, brique et ardoise, est resté pratiquement inchangée depuis son aménagement au début du XVIIe siècle par Henri IV.
Fontaine Charlemagne
8, rue Charlemagne
Métro : Saint-Paul-Le Marais
Adossée au mur du presbytère de l’église Saint-Paul-Saint-Louis, cette fontaine semble être devenue le point de ralliement des élèves du lycée Charlemagne, tout proche, dans la rue qui leur a donné son nom.
On sait qu’elle fut réalisée en 1840, car la date d’exécution est inscrite en grosses lettres romaines, sur la frise supérieure.
Mais la municipalité, représentée par ses armes au centre du fronton triangulaire, n’a pas gardé la trace de l’architecte et/ou du sculpteur.
C’est pourtant un ouvrage relativement monumental et richement décoré.
La fontaine est composée principalement d’une niche semi-circulaire ouverte, encadrée de deux pilastres doriques cannelés.
A l’intérieur de la niche, un groupe en fonte présente des dauphins supportant une vasque dans laquelle un enfant tient à bout de bras une large coquille.
L’eau s’y déverse à ses pieds et finit sa course dans un bassin polygonal.
Sur le haut de la niche, des fleurs et des animaux marins, délicatement taillés dans la pierre, complètent l’ornementation.
Fontaine de l’Archevêché
Square Jean-XXIII, quai de l’Archevêché
Métro : Cité
Ouvert en 1844 au chevet de Notre-Dame par le préfet Rambuteau, le square Jean-XXIII, ex-square de l’Archevêché, fut le premier jardin public de quartier créé à Paris, précédant de quelques années les squares aménagés sous le Second Empire par Alphand.
La mode était alors au romantisme, dont l’application en matière architecturale, se traduisit par l’émergence de nombreux monuments de style néo-gothique.
C’est à cette époque que l’architecte Alphonse Vigoureux et le sculpteur Louis-Parfait Merlieux conçurent, sur le modèle des pinacles de la cathédrale voisine, la fontaine qui orne le centre du jardin.
Celle-ci abrite, au sommet, une Vierge à l’Enfant, entourée, à ses pieds, de trois archanges.
Depuis les socles où se tiennent ces derniers, l’eau se déverse dans un bassin circulaire enchâssé au centre d’un grand bassin octogonal.
Sur ces socles, on peut voir gravé dans la pierre le nom du sculpteur Léopold Kretz, qui signa la restauration de l’édifice vers le milieu du siècle dernier, apportant une touche résolument années 30 aux figures archangéliques.
Texte et photos : © Jacques Barozzi