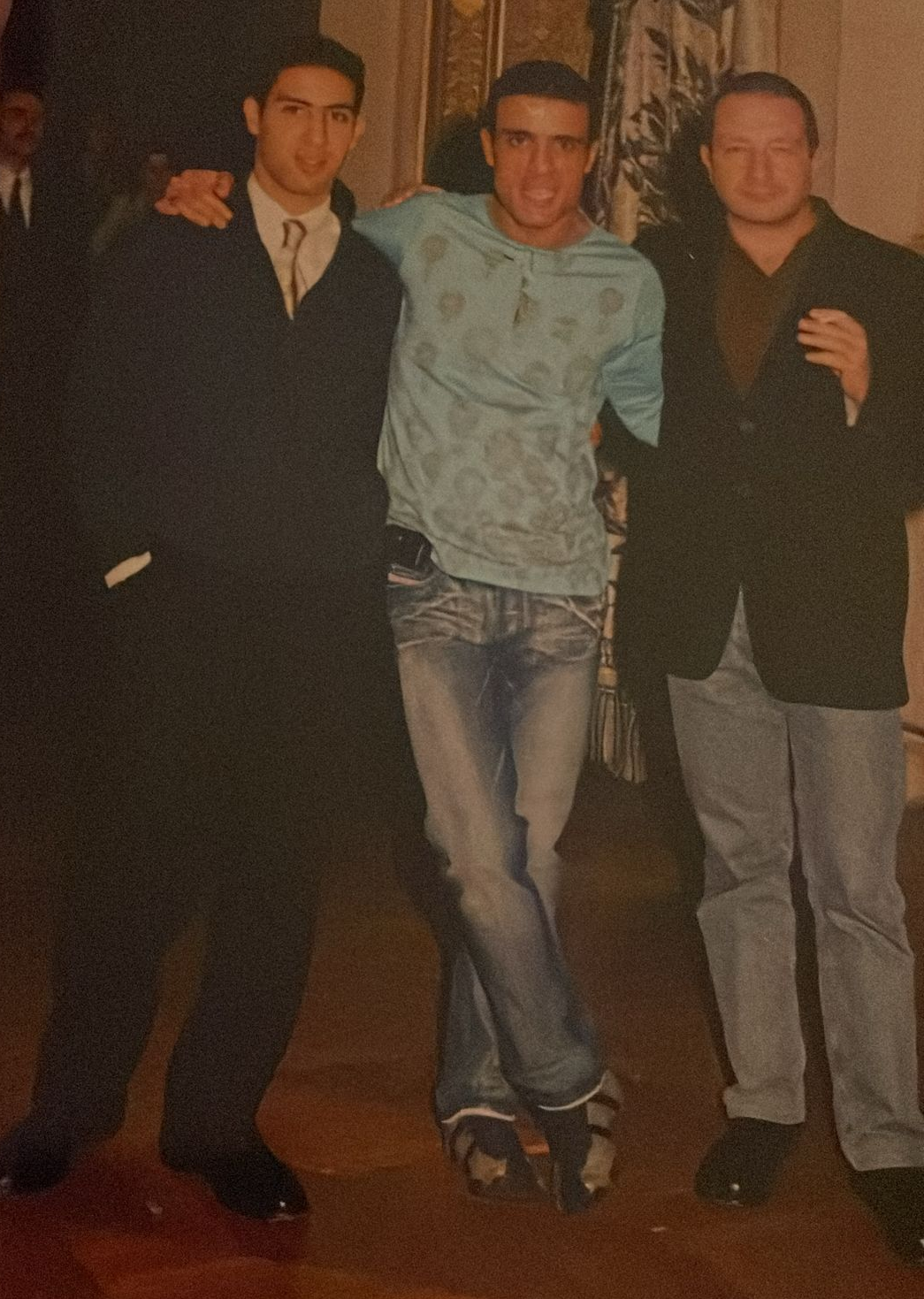1er arrondissement
Fontaine des Innocents
(voir l'article Péril en la fontaine)
Fontaine du Palmier
Place du Châtelet
Métro : Châtelet
La fontaine du Palmier est située entre le théâtre du Châtelet et le théâtre de la Ville. Elle doit son nom aux feuilles de palmiers qui ornent sa colonne, surmontée d’une Victoire ailée.
Installée entre 1806 et 1808 à l’emplacement du Grand Châtelet, rasé par Napoléon, elle est l’œuvre de l’ingénieur Bralle.
La Victoire, du sculpteur Simon Boizot, est une copie : l'original est conservé au musée Carnavalet.
A la base de la colonne, également de Boizot, les figures allégoriques de la Tempérance, la Justice, la Force et la Prudence se donnent la main.
Ce monument avait pour but de célébrer les victorieuses campagnes napoléoniennes d'Egypte et d'Italie, dont les noms gravés dans le bronze sont toujours visibles sur la colonne principale.
Mais rendons plutôt hommage à Napoléon d’avoir fait creuser le canal de l’Ourcq et le Bassin de la Villette, afin de délivrer de l'eau potable gratuite aux principaux carrefours de Paris.
Lors des grands travaux d’Haussmann et du réaménagement de la place du Châtelet, en 1858, la fontaine fut déplacée d’une quinzaine de mètres et rehaussée, passant de 18 à 22 mètres de hauteur.
C’est à l’architecte Davioud que l’on doit le soubassement cirulaire de bassins sur lequel prirent place la colonne et son piédestal carré d’origine.
Fontaine de la Croix du Trahoir
Angle rue de l’Arbre-Sec, rue Saint-Honoré
Métro : Louvre-Rivoli
L’immeuble-fontaine de trois étages, à l’angle des rues de l’Arbre-Sec et Saint-Honoré, fut élevé en 1775 par Soufflot, l’architecte du Panthéon, et décoré par le sculpteur Boizot.
Cet ensemble monumental, aux façades à bossages reproduisant un motif de stalactites, est l’ancien château d’eau qui desservait jadis tout le quartier, alimenté par la pompe de la Samaritaine.
La fontaine de la Croix du Trahoir (ou du Tiroir) a hérité du nom d’une précédente fontaine, érigée en 1529 dans le proche voisinage à l’initiative de François 1er.
Depuis le XIIIe siècle, une potence et une roue étaient dressées sur cette place « pour servir d’exemple aux passants », et les malfrats y étaient exécutés ou châtiés face à une croix. Au quotidien, cependant, on y triait (ou "tirait") des animaux de boucherie.
Rénovée une première fois en 1606, puis déplacée en 1636 à l’emplacement actuel pour permettre une meilleure circulation dans la rue Saint-Honoré, la fontaine primitive -qui s’ornait d’une naïade due à Jean Goujon dont Boizot s’est inspiré pour son haut-relief situé du côté de la rue Saint-Honoré- menaçait ruine lorsque Louis XVI ordonna sa reconstruction.
Fontaine Molière
Angle rue de Richelieu- rue Molière
Métro : Pyramides
En 1673, Molière ne mourut pas sur les planches, comme le veut la légende, mais à son domicile du 40, rue de Richelieu. En 1844, à la suite d'une souscription nationale lancée par l'Académie française, une fontaine fut inaugurée, afin de lui rendre hommage. Celle-ci est située à l’angle des rues de Richelieu et Molière, à deux pas de la Comédie Française, dont le grand homme demeure le fleuron.
Elle a été construite en remplacement d’une fontaine du XVIIe siècle, dite de l’Echaudée-Richelieu, qui avait été détruite car elle gênait la circulation.
C’est à Visconti que l'on doit cet imposant mémorial de style Louis-Philipp.
On peut y admirer, dans une niche monumentale encadrée de colonnes, la statue en bronze, plus grande que nature, de
Molière assis en méditation, réalisée par Bernard Seurre. Deux allégories en marbre l'accompagnent :
la Comédie sérieuse, côté rue de Richelieu, et
la Comédie légère, côté rue Molière, dues au sculpteur James Pradier, dont le ciseau a également taillé les riches ornementations du fronton montrant un Génie assis sur de luxuriantes guirlandes.
Fontaines du Théâtre-Français
Place André-Malraux
Métro : Palais-Royal-Musée-du-Louvre
La place du Théâtre-Français, rebaptisée André-Malraux en 1977, a été aménagée, entre la rue Saint-Honoré et le débouché de la rue de Richelieu à l’occasion du percement de l’avenue de l’Opéra, dont les travaux se sont achevés en 1876.
Elle est constituée essentiellement d’un carrefour et de deux placettes de formes dissemblables sur lesquelles ont été installées, en 1874, les deux fontaines monumentales en pierre que le préfet Haussmann avait préalablement commandées à l’architecte Gabriel Davioud.
Si, au premier coup d’œil, celles-ci paraissent identiques, elles différent toutefois du fait de leurs ornementations en bronze, signées de divers sculpteurs en vogue sous le Second Empire.
La fontaine, côté rue de Richelieu, est coiffée d’une Nymphe fluviale, œuvre de Mathurin Moreau, et décorée, à sa base, d’une Ronde d’enfants due à Charles Gauthier.
Tandis que la fontaine située du côté de la rue Saint-Honoré accueille, elle, en son sommet une Nymphe marine, réalisée par Albert-Ernest Carrier-Belleuse - un des précurseurs de l'Art nouveau - et, à sa base, une Ronde d’enfants, que l’on doit à Louis-Adolphe Eude.
Fontaines du Palais-Royal
Jardins du Palais-Royal
Métro : Palais-Royal-Musée-du-Louvre
Haut-lieu historique de la capitale, le Palais Royal présente au promeneur une gamme de points d’eau qui ont réactivé dernièrement à Paris la vieille querelle entre les Anciens et les Modernes.
Au grand bassin circulaire agrémenté d'un jet d’eau en éventail, installé au centre des jardins à la Restauration se sont adjointes, en 1985, les deux fontaines "Sépharades" du sculpteur Pol Bury.
Les grosses boules mobiles, en acier inoxydable, ruisselantes d’eau et placées sur une large coupelle inscrite au centre d’un bassin carré, sont installées de part et d’autre de la galerie d’Orléans, entre le Conseil constitutionnel et le ministère de la Culture.
Ces deux fontaines se sont particulièrement bien intégrées dans le site : les colonnades et les façades de pierre environnantes, s’y reflètent avec harmonie.
En revanche, on se souvient que les fameuses colonnes de Daniel Buren, aménagées en 1986 dans la cour d’honneur voisine, firent couler beaucoup d’encre et sont toujours source de polémique.
Au point que l’on en oublie que ce vaste alignement de colonnes tronquées de diverses tailles, rayées de noir et de blanc ainsi que les stores des bâtiments alentour, et aux pieds desquelles glisse une nappe d’eau souterraine est avant tout... une fontaine, dénommée Les Deux Plateaux.
Bassins du musée du Louvre et du jardin des Tuileries
Angle place du Louvre, rue de Rivoli
Métro : Louvre-Rivoli
Depuis la célèbre colonnade du Louvre, bâtie de 1667 à 1674 par Claude Perrault, jusqu’à la place de la Concorde, à l’autre extrémité du jardin des Tuileries, le Grand Louvre, dont les travaux se sont échelonnés entre 1981 et 1999, propose désormais un cheminement linéaire balisé de bassins et de jets d’eau s’alignant sur la fameuse perspective dessinée au XVIIe siècle par Le Nôtre.
Un premier grand bassin circulaire avec jets d’eau, au centre de la cour Carrée, accueille depuis longtemps le visiteur.
Mais c’est après avoir passé sous le porche du pavillon de l’Horloge, et en pénétrant dans la cour Napoléon, que s’offrent à notre vue les jaillissements les plus spectaculaires de la promenade.
Là, autour de la pyramide de verre de Ieoh Ming Pei, qui marque l’entrée principale du plus grand musée du monde, l’architecte sino-américain a aménagé un ensemble de sept bassins triangulaires aux margelles de granit poli d’où s’élèvent vers le ciel d’impressionnantes gerbes écumantes.
Plus loin, après l’Arc de Triomphe du Carrousel, en entrant dans le jardin, le grand bassin rond du XVIIe siècle, avec sa vasque centrale et son sage jet d’eau, permet de renouer avec l’esprit originel des lieux.
Enfin, avant d’atteindre le grand bassin octogonal, qui clôt le parcours, on peut encore admirer, sur la gauche, la nouvelle pièce d’eau réaménagée à l’occasion des dernières modifications paysagères du jardin.
De style plus pittoresque, on y retrouve Apollon poursuivant Daphné, moulage de l’œuvre réalisée en 1714 par Nicolas Coustou, qui avait été installée dans le jardin en 1797, et dont l’original est désormais conservé au Louvre.
Texte et photos : © Jacques Barozzi