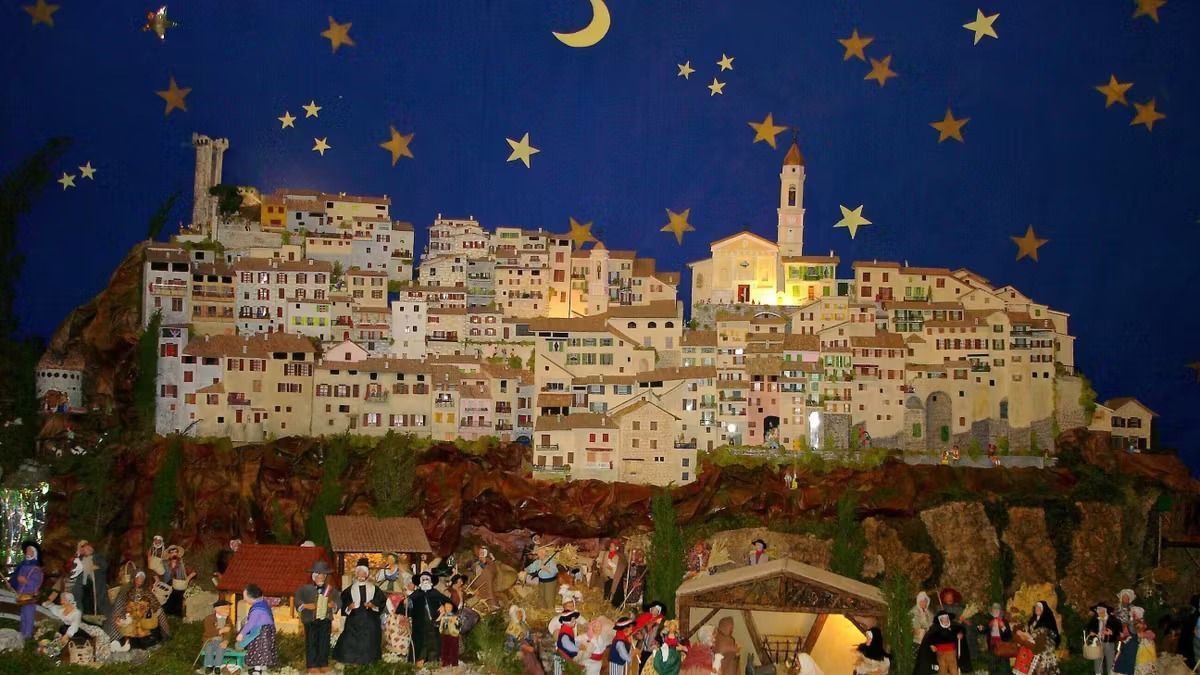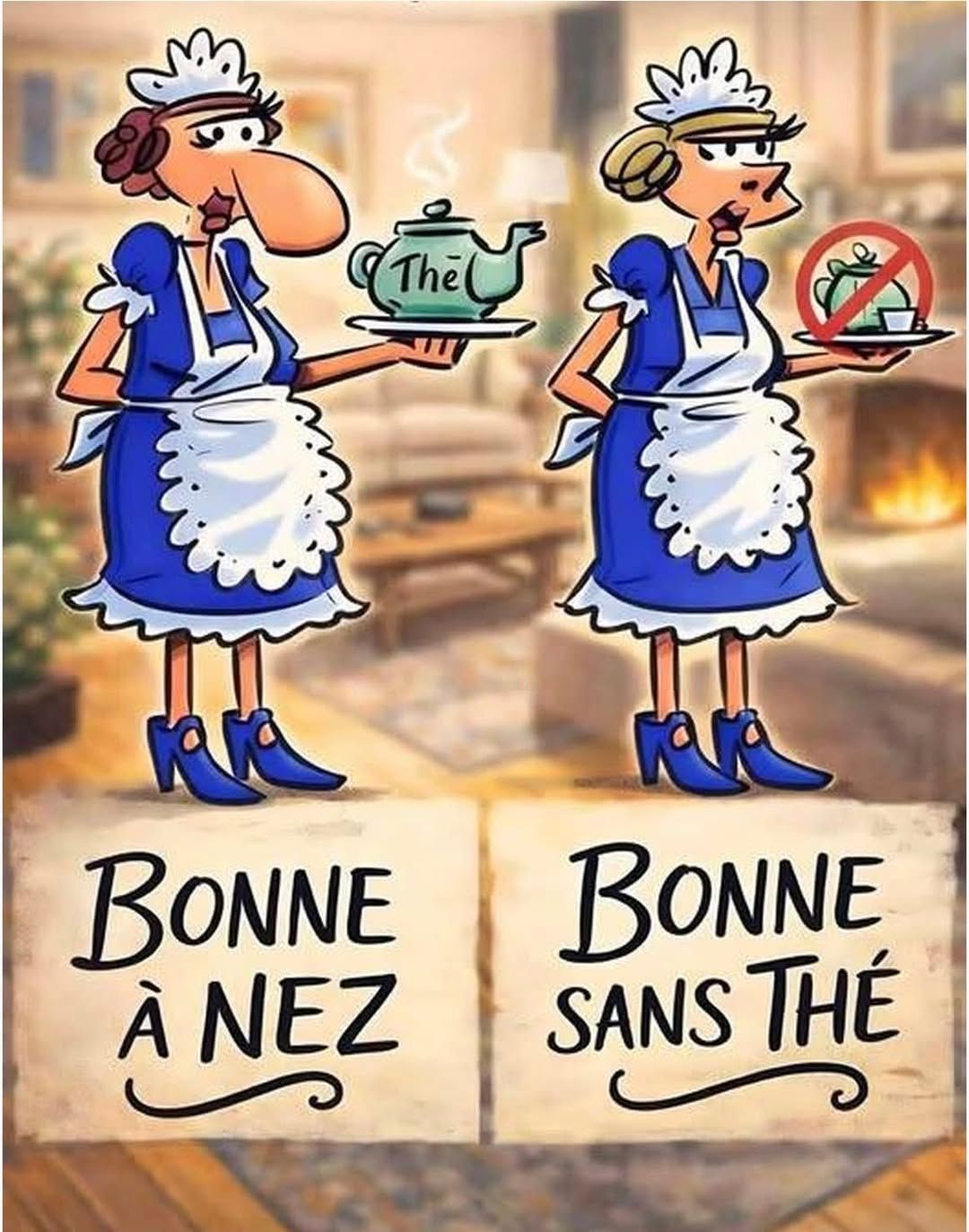« R.M.N. » de Cristian Mungiu, avec Marin Grigore, Judith State et Macrina Bârlădeanu.
Palme d'Or au Festival de Cannes en 2007 avec son deuxième long métrage, « 4 mois, 3 semaines, 2 jours » (l'histoire d'un avortement clandestin en 1987, sous le régime de Ceaucescu), le cinéaste roumain Cristian Mungiu était de retour en compétion cette année avec « R.M.N. »., qui, une fois n’est pas coutume pour cet habitué des distinctions cannoises, est reparti bredouille.
Nul démérite pourtant pour ce film situé dans un petit village de Transylvanie, et qui aborde de front les thèmes de la précarité, de la discrimination et du populisme !
Avec cette fable contemporaine, dont le titre R.M.N. est l'acronyme roumain d’I.R.M., Mungiu nous propose en effet pas moins qu’une radiographie en profondeur de la Roumanie actuelle.
Un examen local à portée universelle.
Quelques jours avant Noël, Matthias (Marin Grigore), un brun viril, qui a perdu son emploi dans un abattoir en Allemagne, pour avoir donné un coup de boule malencontreux à son contremaître (celui-ci l’avait traité de gitan, l’injure suprême pour un Roumain), est de retour chez lui : un village de montagnes multiethnique aux confins de la Roumanie et de la Hongrie.
Là, il y retrouve son vieux père malade, son fils Rudi, qui ne parle plus depuis qu’il a vu une scène effrayante dans la forêt, ainsi que son épouse avec laquelle il est en instance de divorce.
Rien de moins bucolique que ces retrouvailles, qui lui permettent néanmoins de renouer avec sa maîtresse, Csilla (Judith State), une belle femme au corps souple et musclé, qui joue du violoncelle dans la chorale paroissiale et dirige la fabrique de pain local.
Dans ce microcosme rural symbolique, que la caméra de Mingiu ausculte au scalpel du réalisme, non sans quelques pointes d’irrationnel, voire de fantastique, c’est toute la problématique de la mondialisation qui est en jeu.
Ici, la plupart des hommes, à l’exemple de Matthias, sont partis travailler en Europe, où les salaires sont nettement plus élevés.
Mais quand l’entreprise que Csilla dirige, faute de trouver du personnel sur place, décide de recruter trois employés sri lankais au teint cuivré, la petite communauté s’embrase.
Remarquable scène de 17 minutes filmée en plan-séquence dans la salle des fêtes du village, où les habitants font part au maire, au curé, ainsi qu’à la patronne de la fabrique de pain de leur refus d’accueillir des étrangers chez eux, rappelant leur fierté d’en avoir chassé les gitans, et malgré les Hongrois et les quelques Allemands plus ou moins bien intégrés à la communauté villageoise, c’est toute la xénophobie sous-jacente qui remonte à la surface.
Non sans violence et contradictions, car ceux-ci veulent bien recevoir les subsides et les aides de l’Union Européenne, mais refusent fermement d'en acquitter la contre partie.
Un film choral, où Matthias se révèle passif face aux évènements et dont Csilla est la seule héroïne positive, et où malgré les ours, les loups et les renards qui menacent à l’orée du village (contre subvention de Bruxelles, le maire a accepté de transformer la forêt environnante en parc naturel), trois pauvres travailleurs immigrés, pourtant chrétiens, sont interdits de participer à la messe de Noël.
Un film éminemment politique, qui donne à voir et réfléchir par temps de populisme galopant !
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597971&cfilm=299722.html